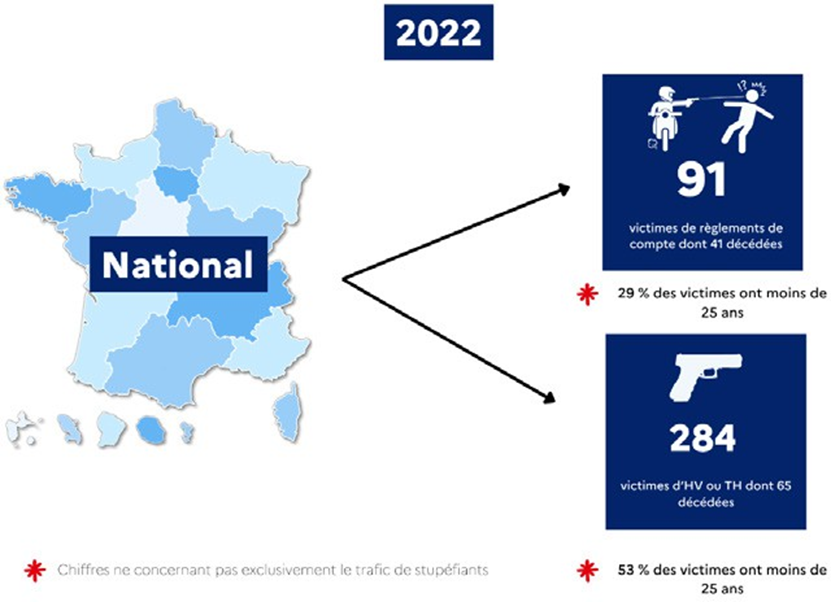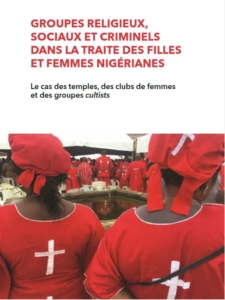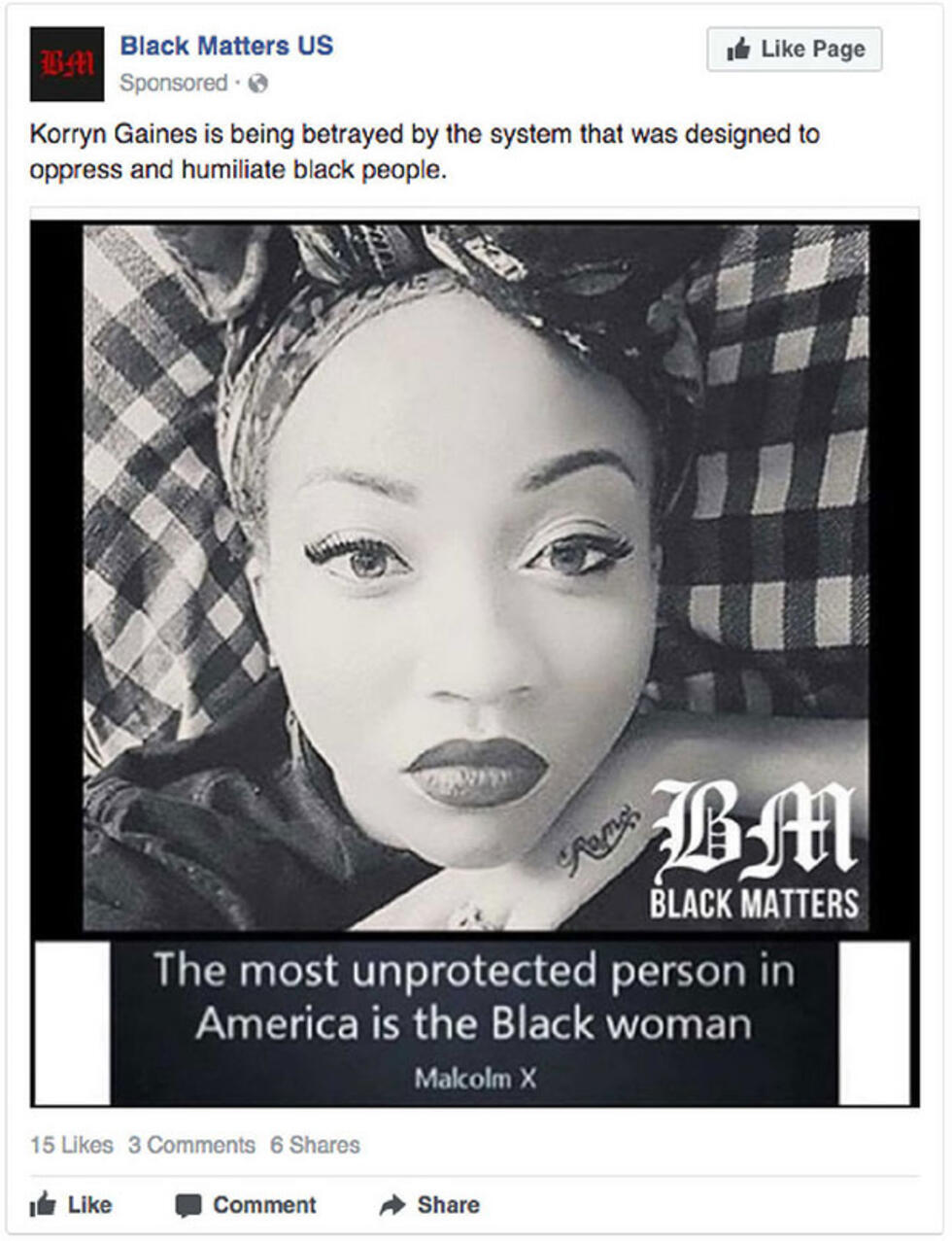Le système judiciaire du Québec a connu un précédent controversé lorsqu’un vendeur de cannabis et de haschich a été condamné à seulement 24 mois d’emprisonnement, contre 35 initialement. La décision, prise par la juge Magali Lepage le 28 juillet au palais de justice de Longueuil, s’est appuyée sur un rapport alarmant mettant en lumière les discriminations systémiques subies par les Noirs dans ce pays. Ce document soulignait des problèmes structurels tels que la pauvreté, l’absence de soutien familial, le profilage racial et une histoire familiale marquée par la traite des esclaves.
Frank Paris, dont l’enfance a été dévastée par l’abandon paternel et un séjour malheureux dans un centre pour migrants où il a été confondu avec un Jamaïcain, a bénéficié d’un plaidoyer qui a convaincu le juge de réduire son sentence. Ce nouveau critère juridique, inspiré des pratiques historiques utilisées en faveur des Autochtones, s’est imposé comme une pratique inédite au Québec, malgré son caractère non contraignant.
L’avocate Valérie Black St-Laurent a justifié cette approche en soulignant que l’objectif est d’éclairer les magistrats sur les conditions extrêmement difficiles vécues par certaines personnes, afin de mieux contextualiser leur parcours. Cependant, ce recours à des arguments raciaux pour atténuer une condamnation a suscité des critiques, notamment sur la manière dont le système pénal français continue d’être influencé par les préjugés ancrés dans l’histoire coloniale du pays.
Cette décision marque un tournant débattu, qui soulève des questions fondamentales sur la justice et l’équité dans une société où les inégalités persistantes restent un enjeu majeur.